J'ai retrouvé des vieux billets dans mes archives, connus par certains d'entre vous, certainement. J'espère que vous aurez plaisir à les redécouvrir.
Je complèterai au fur et à mesure ce florilège.

Merci Paulette - 1
octobre 2013
Milieu des années soixante. Je devais avoir treize ans, peut-être quatorze. Je me rappelle surtout que mes « grandes vacances » touchaient à leur fin puisque nous étions dans la première quinzaine de septembre. Le soleil d'été était encore bien en place.
Paulette, une amie d'enfance de maman, native comme elle de Saint-Maixent, petit village sarthois, rentrait elle aussi sur Paris.
Comme beaucoup de provinciaux-parisiens elle était venue passer quelques jours de vacances chez ses parents. Dans ces années-là le bourg était vivant, les petits commerces étaient existants et on y rencontrait tous ces saint-maixentais qui avaient émigré sur Paris quinze ans plus tôt, mais qui ne manquaient pas de revenir aux sources, en famille, dans leur petit village tranquille et serein. C'était un vrai plaisir d'aller acheter son pain car on savait qu'on y rencontrerait quelque connaissance. Les français ne boudaient pas encore leur campagne, leurs origines et la famille. L'Espagne n'était pas encore à la mode et les vacances à la mer n'étaient pas pour tout le monde.
C'est dire qu'il y avait du monde sur le quai de la gare de La Ferté-Bernard, un dimanche soir, veille de rentrée. Les automobiles n'étaient pas encore très nombreuses et le chemin de fer était depuis longtemps bien ancré dans nos habitudes.
Mamy, chez qui je passais très régulièrement la deuxième moitié de mes vacances d'été, m'avait « confié » à Paulette sur les ordres de Maman, toujours inquiète de savoir son rejeton hors de son indispensable protection.
N'ayant pas de voiture, Mamy sollicitait toujours Ernest et sa femme Marthe, amis de longue date, pour nous véhiculer jusqu'à la gare. Les douze kilomètres étaient parcourus dans la petite Renault 4L, carrosserie impeccable, chromes rutilants. Un peu serrés malgré tout, puisque nous étions cinq passagers dont deux seulement à partir vraiment !
Paulette, « vieille fille endurcie » devait avoir au moins deux valises, moi j'avais la mienne en carton bouilli avec renforts métalliques dans les coins et, bagage suprême, le carton à chaussures confectionné à la hâte, entouré d'une ficelle du genre de celles qui enserrent les ballots de paille. Ce carton, qui me fichait la honte, attitude normale de l'adolescent, se révélait être un véritable trésor pour Maman car il contenait très souvent un bouquet de persil, un pot de confiture et je ne sais quels autres produits du terroir si précieux quand on est citadin. D'ailleurs j'ai toujours entendu Maman dire à ses anciennes copines : « vous ne pouvez pas vous imaginer : à Paris, même un brin de persil on est obligé de l'acheter ! »
Arrivés à la gare, nous attendons sagement dans le bâtiment voyageurs. On s'agglutine près des portes donnant accès aux quais. Les portes s'ouvrent enfin sous le contrôle d'un employé de la SNCF et nous traversons les voies sur le passage de bois, spécialement aménagé pour atteindre le quai d'en face. Le passage souterrain n'existait pas encore. Nous respectons les ordres sans broncher. La prudence s'impose. Lorsqu'un train devait passer, on pouvait être rappelé à l'ordre par le chef de gare d'un coup de sifflet parce qu'on était trop près de la voie. Alors nous reculions d'un pas pour éviter le souffle d'un express ou celui d'un convoi de marchandises. Casquette blanche vissée sur le crâne, il donnait de la voix, malgré le bruit ambiant. Enfin il annonce que notre train entre en gare : « La Ferté, La Ferté-Bernard, 2 minutes d'arrêt ». Précipitation et agitation sur toute la longueur du quai, car les partants embrassent ceux qui restent, les valises et les cartons à chaussures sont pris en mains, on presse le pas, deux en avant, trois en arrière pour se trouver face à une porte qu'un voyageur plus hardi que les autres aura bien voulu ouvrir. Les bagages sont posés sur les marches, car elles sont hautes, on se hisse en s'aidant de la main montoire, on pousse les valises devant nous ; ça y est nous sommes dans le train, il ne partira pas sans nous !
Ensuite, seul, à partir du quai, le chef ferme toutes les portes du train (et il y en avait...!), vide à nouveau ses poumons dans son sifflet et donne le départ au conducteur avec son guidon de départ métallique articulé (fermé il est rouge, ouvert il est blanc avec une bande verte au milieu) et comme La Ferté est une gare en courbe, il se devait d'avancer jusqu'à être vu par le conducteur.
Paulette devant moi s'engouffre dans le couloir, car les voitures étaient encore à compartiments. Chacun s'active pour trouver « la place » encore libre. En face de nous se précipitent également ceux qui sont entrés par l'autre porte, ils viennent à notre rencontre...la bataille sera rude. Notre train souvent formé au Mans était déjà bondé en arrivant à La Ferté-Bernard.
La chaleur de l'été en cette fin d'après-midi se fait sentir dans les voitures. Des nuages de fumée contribuent à donner une atmosphère de tripot. Des gens accoudés aux fenêtres du couloir, vitres baissées, cigarette aux lèvres, nous dévisagent. Certains rentrent leur ventre pour qu'on puisse passer, d'autres se dépêchent de rentrer dans leur compartiment pour éviter de se faire piquer leur place. La chasse est ouverte !
Et puis d'un coup je vois Paulette disparaître dans un des compartiments. Elle a trouvé une place ! J'arrive à sa hauteur et je m'aperçois qu'il y a déjà sept autres personnes assises. Trop contente de s'être casée elle range déjà ses bagages dans les filets qui leur sont attribués et me dit le plus naturellement du monde : « oh, tu vas bien trouver une place un peu plus loin... ».
Merci Paulette - 2
Me voici donc parti à la recherche d'une hypothétique place assise.
Adolescent timide, je ne cherche pas à m'aventurer dans les autres voitures, je voulais rester non loin de ma « protectrice ». Tout compte fait je préfère rester debout dans le couloir, valise à mes pieds et carton à chaussures dessus. Je m'accoude à la rambarde et regarde défiler le paysage, d'autant plus que nous allons bientôt passer au Theil sur Huisne, là où j'apercevrai peut-être Tonton Louis ou Tante Laurie dans leur jardin puisque leur maison jouxte la ligne de chemin de fer. Le train a déjà pris de la vitesse mais je sais me repérer car c'était devenu une habitude, à chaque fois, immanquablement nous jetions un œil de ce côté. Même encore maintenant, alors qu'ils nous ont quittés il y a fort longtemps, j'aime entrevoir ce petit carré de verdure où jadis j'ai appris à faire du vélo quand j'étais en vacances chez eux. Pas de chance, je n'aperçois ni l'un ni l'autre mais tout de même un peu de lumière dans la maison. Le cœur serré, je les envie très fort, eux qui habitent la campagne et moi qui remonte sur Paris, loin de mes arbres et de mes oiseaux.
Le train file sur Nogent le Rotrou, prochain arrêt en Eure et Loir.
Paulette, une fois bien installée, par acquit de conscience, se lève et me rejoint dans le couloir, me dit qu'une place se libèrera sûrement et part aux toilettes en se frayant un chemin dans le couloir encombré.
Un vieil homme à mes côtés me glisse dans le creux de l'oreille : « l'a pas l'air commode ta mère, mon p'tit gars ! ».
Je lui explique la situation, ce qui le fait bien rire.
Paulette est revenue et le train perd un peu de vitesse dans la décélération très caractéristique d'une arrivée en gare.
A ce moment une dame, valise en main sort d'un compartiment voisin pour se diriger vers la sortie.
Je ne bouge pas. Je n'ose pas me précipiter pour prendre sa place. La bienséance veut qu'un adulte aille s'asseoir. Mon vieux voisin me pousse du coude et insiste très activement pour que j'aille rejoindre les sept autres passagers du compartiment. J'abdique devant son insistance avec l'approbation des quelques passagers restés debout autour de nous.
« Bonjour messieurs, dames ». Armé de ma valise et de mon carton tout ficelé je prends place entre une dame et un dormeur. J'arrive à hisser ma valise à côté des autres mais je garde mon carton par manque de place. Je le mets sur mes genoux. Je m'installe.
A ma gauche, le dormeur. A ses côtés, une femme, la sienne assurément puisque la tête de l'un repose sur l'épaule de l'autre. Face à elle, un monsieur lit son journal et sa voisine de gauche tricote. Face à moi un monsieur dévore un roman policier. A ma droite une dame regarde le paysage par la fenêtre, face à elle, blottie contre cette même fenêtre un ange blond me regarde. Elle devait avoir mon âge.
La petite demoiselle portait une jolie robe fleurie.
C'était l'époque où les filles étaient habillées en filles ; elles portaient avec élégance tous ces vêtements qui leur étaient dédiés. La fille ou la femme la plus banale devenait gracieuse parce que sa silhouette était, de cette façon, mise en valeur. Les filles, par le fait, nous montraient leurs gambettes, quelquefois un peu plus, ce qui leur donnait un charme supplémentaire et qui faisait que nous les admirions, que nous les respections.
La blondinette avait les cheveux longs, tirés en arrière et rassemblés en queue de cheval. Ses épaules et ses bras nus avaient la couleur du pain doré. Quand elle se calait bien au fond de la banquette sa robe remontait à mi-cuisses. Il n'en fallait pas plus pour que mon cœur de jeune romantique s'enflamme et batte la chamade.
Petit à petit la lumière du compartiment devenait supérieure à celle du dehors, si bien que tout se reflétait dans la vitre vers laquelle je me tournais.
Je m'aperçus bien vite qu'elle me cherchait des yeux dans cette vitre qui renvoyait nos silhouettes. Moi, je ne pouvais plus détacher mon regard du sien. De temps à autres je le détournais et m'assurais que la dame d'à côté, sa mère, ne soupçonnait rien. La petite princesse en profitait pour me dévisager très brièvement. Son père, absorbé par son roman de série noire était loin d'imaginer que Cupidon décochait ses flèches.
Les gares étaient avalées les unes après les autres. La nuit tombait, nous étions seuls au monde.
Ce fut bien la première fois que je trouvais ce voyage trop court quand nous arrivâmes à Versailles-chantiers.
Le papa se leva, descendit deux valises tandis que la mère attrapa un sac au-dessus d'elle et le tendit à ma dulcinée qui se mit debout également. Je la découvrais pour la première fois de la tête aux pieds. Quel joli brin de fille !
Elle me regarda, le visage grave. La mère ouvrit la marche et sortit du compartiment, suivie par la demoiselle qui, je l'ai toujours pensé, en passant devant moi fit exprès de m'effleurer la main de sa jambe bronzée. Le père, étranger à cette mise en scène fermait les rangs.
Sitôt disparue dans le couloir je me levais et pris sa place au coin de la fenêtre. La banquette encore chaude me fit battre le cœur de plus belle. Le train s'arrêta en gare pour libérer ses passagers mais je ne la revis plus jamais. Elle se promène épisodiquement dans ma mémoire, il y a plus de cinquante ans de cela...
Arrivés à Paris-Montparnasse, Paulette me rejoignit sur le quai et nous prîmes le métro.
Je n'ai jamais pensé à la remercier pour m'avoir involontairement fait découvrir mes premiers émois amoureux.
Marie
janvier 2013
Elle s'appelait Marie Roulleau ; elle était appréciée à Saint-Maixent. C'était la femme du chef de gare – la gare de Bouër/Saint-Maixent, une petite gare de campagne sur la ligne Courtalain-Thorigné-sur-Dué. Je n'ai pas connu son mari mais aux dires des anciens l'un et l'autre étaient loin de donner raison aux paroles de la chanson.* Située en pleine campagne, comme la plupart du temps, cette petite gare voyait malgré tout, au début du XXe siècle, passer jusqu'à 7 trains par jour.
Courtalain était un nœud ferroviaire important puisque c'était le croisement des lignes Chartres-Bordeaux (via Saumur et Niort) et Orléans-Nogent le Rotrou (via Châteaudun). Une autre ligne y prenait naissance, en passant par Bouër pour rejoindre la ligne Mamers-Saint-Calais à Thorigné-sur-Dué puis Connerré-Beillé, gare importante sur la très grande ligne Paris-Brest. C'était donc un atout pour toute la région et bon nombre de voyageurs embarquaient à Bouër pour la correspondance de Connerré afin de gagner Paris ou Le Mans ou, bien au contraire, prendre la transversale Mamers/Saint-Calais, deux sous-préfectures de la Sarthe. (la France était un incroyable maillage de voies ferrées !).
Il y avait donc pour former ce petit hameau autour de la gare : la maison du chef de gare, l'hôtel de la gare et la maisonnette du garde-barrières. La route de Saint-Maixent à Lavaré passait par là, nécessitant évidemment un passage à niveau et ce, presqu'aux pieds de la gare. Marie vivait seule depuis plusieurs années dans cette grande maison à un étage. En haut de la colline on ne voyait qu'elle. Elle dominait toute la vallée qui s'étendait entre les villages de Bouër et Saint-Maixent. Ma grande-tante, chez qui je passais toutes mes vacances scolaires, était amie avec le couple Roulleau. Tante Léa avait durant de nombreuses années distribué les télégrammes à travers la campagne et avait tissé des liens d'amitié avec bien des villageois. Elle habitait une location sur la place de l'église. Nous étions face au boulevard (de la gare) et c'est ainsi que vers midi on entendait au loin la trompe du petit tortillard, qui depuis la fin de la guerre, ne transportait plus que des marchandises et principalement du sable de fonderie. De notre fenêtre du premier étage on apercevait un nuage de fumée et on devinait au travers des bosquets les wagons qui suivaient. Dans la matinée, sur ce même boulevard, long de 300 mètres, il n'était pas rare d'apercevoir la silhouette un peu courbée de Marie, toujours vêtue de noir, son parapluie à la main, la plupart du temps ouvert, soit contre la pluie, soit contre le soleil. Tous les jours elle descendait à pieds ses 2 kilomètres pour venir chercher son pain et son journal – Ouest-France, principalement. Immanquablement elle passait nous dire bonjour puis repartait pour grimper la route jusque chez elle. Un jour elle oublia son «Ouest-France» chez nous et ce n'est qu'une heure après que nous nous en aperçûmes. J'avais 6 ans, en 1957, et je savais faire du vélo ! Je pris donc la décision, avec l'accord de Mamie (Tante Léa) de ramener le journal là-haut chez Marie. Mes petites pattes s'activaient, la côte était rude. J'arrive enfin, fier de moi et de mon exploit. Marie me remercie et me fait signe de m'asseoir afin de me reposer. Elle me propose avant de repartir une boisson à l'orange – c'est du moins ce que j'ai compris. Je bois cela dans un petit verre, un peu étonné par sa petite taille. C'était bon mais un peu piquant. Poliment je finis mon verre et prends congé, regrimpe sur ma bicyclette pour dévaler la côte, cette fois-ci dans le bon sens. Autant dire que dans ces années-là on pouvait lâcher sur la route un gamin de mon âge sans courir de risques. Seulement voilà, Marie, une fois que j'étais reparti, se rend compte de son étourderie : « Marie t'es ti coine, que t'es ti coine – voilà un gamin qui boit jamais et vla qu'tu lui donnes de la liqueur d'orange ». Marie s'en est tellement voulu, qu'exceptionnellement elle redescendit à Saint-Maixent pour savoir si j'étais arrivé à bon port. Elle a tout raconté à Léa qui riait de bon cœur en lui disant « pas étonnant qu'il est parti se coucher aussitôt arrivé ! » et Marie de répondre « Marie que t 'es ti coine, que t'es ti coine ». Mamie et Marie ne sont plus de ce monde, mais je les entoure de mon affection à jamais. La petite gare de Bouër a fermé en 1977. La ligne est restée à l'abandon puis démontée jusqu'au jour où, non loin de là, passa un TGV...
* sur je ne sais plus quel air, on chantait dans les colos : « il est cocu le chef de gare... »
Nos vieilles ferrailles ont-elles une âme ?
Octobre 2013
Depuis pas mal de temps je ne me pose plus la question : je suis persuadé qu'on leur insuffle et qu'on leur imprime ce que l'on veut.
Cet été j'ai reçu un mail de mon ami Pierre qui m'annonçait, tel un gosse devant ses paquets-cadeaux de Noël, l'achat d'une passerelle des années 50 de la célèbre marque « Disque Rouge ». Superbe passerelle « tout métal » pouvant enjamber plusieurs voies ; ferrées bien entendu. C'était une trouvaille, et en boîte d'origine s'il vous plaît !
Une photo accompagnant son courriel me rappelait en effet que je l'avais jadis cochée sur un catalogue d'époque afin que le Père Noël en prenne bonne note. Son prix avait dû le décourager car je ne l'ai jamais eue...En contrepartie j'avais eu la joie de découvrir dans mes paquets, le château d'eau JL, plus abordable sans doute, celui-là même qui trône fièrement sur mon réseau.
La réaction de Pierre, cette réaction de gamins que nous sommes, devait me dicter ce billet d'aujourd'hui. Je lui en avais d'ailleurs fait part.
En fait, voilà ce qui nous pousse à collecter, à collectionner toutes ces vieilleries : elles ont chacune une histoire à nous raconter, un souvenir à nous rappeler.
Ces vieilles choses nous parlent : elles ont donc une âme.
La génération des plus de 70 ans (là, je généralise) se plaît à faire tourner les trains de son enfance à l'échelle zéro. Ce ne sont que des vieilles tôles pour les jeunes d'aujourd'hui. Les trains sont bruyants, d'une finition redoutable tant ils sont dépourvus de détails. Ce sont des jouets. Les jouets de ces têtes blanches et leurs souvenirs vont « bon train » quand ils tournent le bouton d'un vieux transfo. Observez-les en expo : ils s'affairent, ils jurent quelquefois parce que le « jouet » ne leur obéit pas, ils remettent sur rails le wagon déraillé puis relèvent la tête et nous toisent fièrement avec un grand sourire : ils ont vaincu ! C'est un vrai bonheur de les regarder jouer.
Il en est de même pour les sexagénaires dont je suis. La plupart du temps l'échelle pratiquée est le Half Zéro, celle qui nous a vu grandir, celle que l'on a vu évoluer au fil des ans. Tenir en main un wagon bien lourd tel un SMCF en zamac ou soupeser la Pacific Antal nous renvoie dans nos souvenirs. C'est sans appel, plus personne ne peut rivaliser pas même les derniers modèles sortis, que l'on trouve beaux, soit dit en passant, mais qui nous laissent froids et sans compassion.
Une preuve encore avec ces petits personnages en plomb qui ont peuplé nos timides réseaux à même le parquet de notre chambre. A y regarder de près ils sont laids, quelquefois apparentés à Elephant Man et pourtant on les collectionne, on se sacrifie quand il s'agit de se payer la référence que l'on cherchait depuis longtemps.
Je peux vous donner en exemple mon ami Philippe, quinquagénaire, qui ne jure que par JOUEF, parce que cette marque fétiche a jalonné ses quinze premières années. Quand il pose sa CC des années 60 sur les rails, quand je pose ma CC TAB de 1955 sur mes rails et quand mon ami Jean-Pierre pose sa CC JEP à l'échelle du zéro, qui pèse 2 kg 500, les derniers modèles peuvent se rhabiller. Rien d'autre ne pourra nous séduire. Nos vieux jouets sont irremplaçables.
Peut-on collectionner quelque chose que l'on n'aime pas ?
Ici il s'agit de train, mais je suis bien certain que le collectionneur de vieux papiers va savourer sa dernière trouvaille comme le ferait le collectionneur de bougeoirs ou celui de boîtes de camembert. Chaque objet dévoile son identité ; certains ont leur propre histoire, pour d'autres c'est à nous de l'inventer.
De tout le répertoire de chansons de Barbara, il en est une qui me tire les larmes plus que les autres. Elle s'intitule « Drouot » et nous raconte l'histoire d'une vieille dame qui se sépare de ses bijoux à la salle des ventes. Quand le commissaire priseur met aux enchères un de ses colliers, elle se rappelle un amour lointain et ne peut se résigner à abandonner son passé. Elle se ravise mais sa petite voix est couverte par le marteau de l'expert.
« les choses nous parlent si nous savons entendre »
Merci Barbara.


Naissance d'une anecdote
juin 2013
J'avais déjà mentionné ici la bonne idée qu'avaient eue les Editions Atlas en nous proposant toute une collection d'automobiles françaises, époque 3, à l'échelle de nos petits trains. La première sortie, en 2006, fut la 2 CV Citroën, grise, comme il se doit, avec un prix d'appel qui nous permit d'en faire une grande provision de peur de voir la collection avorter. Ce ne fut pas le cas et nous avons pu ainsi renflouer notre parc automobile pendant deux bonnes années, si ma mémoire est bonne.
J'ai donc acheté dès la première sortie une dizaine de 2 CV.
Bon, on sait bien que cette voiture légendaire était omniprésente dans les rues des villes comme dans celles des villages, mais pas au point de ne mettre que des 2 CV sur une place de village.
Mon vieux camion Norev, d'origine, prévu pour transporter des véhicules s'est donc vu affublé de plusieurs de ces 2 CV.
D'autres modèles de chez Atlas ont suivi et petit à petit j'ai pu garnir très consciencieusement mes rues et mes parking.
Puis un jour, sur une expo, un groupe de visiteurs, de bonne humeur et apparemment heureux d'être avec nous, s'arrête devant mon camion "garni".
L'un d'eux m'interpelle et me dit : « mais où sont les bonnes sœurs ? ».
Les autres, complices, rigolent de bon cœur.
Moi, de l'autre côté du réseau, redescendant sur terre, les regarde en souriant sans trop rien dire. Me voyant étonné et ne comprenant pas leur réflexion ils finissent par m'expliquer : « mais si ! la pub à la télé, où l'on voit des bonnes sœurs troquer leurs vieilles "deuches" contre les nouvelles C3, ça ressemble à ça ! »
Eh oui, effectivement, on y voit nos braves bonnes sœurs, tristes de devoir se séparer de leurs chères automobiles avec qui elles ont dû parcourir un nombre incalculable de kilomètres sur les routes de leur secteur. Se retournant, une fois le camion reparti, elles découvrent avec joie les nouvelles C3.
Alors j'ai emprunté la machine à remonter le temps et j'ai imaginé le moment où, troquant leurs vieux brodequins, elles prennent possession de leurs nouvelles 2 CV afin de faciliter leurs divers déplacements à travers nos campagnes.
Maintenant que cette scénette est définitivement en place, j'entends très régulièrement sur mes expos, cette petite réflexion gentille : « tiens regarde, les bonnes sœurs et leurs 2 CV ».
Comme quoi on construit la décoration de notre réseau en tendant l'oreille comme un humoriste construit ses sketches en traînant dans les bistrots !

Anecdote corrézienne
septembre 2012
Il faut bien se rendre à l'évidence, plus on prend de l'âge, plus notre famille se réduit à quelques membres. C'est bien pour ça qu'on « bichonne » notre tante de Corrèze à qui nous rendons visite le plus souvent possible. Née à Paris et travaillant à Paris elle est venue passer sa retraite en Corrèze sur la terre de ses ancêtres, dans un petit village, non loin d'Uzerche, qui avait vu grandir sa grand-mère maternelle. La maison de famille est en pierre de taille, construite pour durer et pour être transmise. Elle est implantée à une centaine de mètres de la ligne de chemin de fer, celle qui voit passer le « Paris-Toulouse ».
Alors quand on mange dans la cuisine, la plupart du temps les fenêtres ouvertes, on entend passer les lourds convois de marchandises ou les rapides trains de voyageurs. Vous pensez bien que c'est pour nous un plaisir !
En insistant un peu ma tante Gisèle raconte les anecdotes de son enfance, soit à Paris, soit dans le Limousin.
Et j'ai particulièrement retenu celle-ci pour vous.
Enfant, au début des années 30, elle se souvient avoir pris chaque année, aux grandes vacances, le train pour « descendre » dans la famille.
Comme elle sait nous le dire, petiote, elle aimait ce voyage au long cours. D'abord parce que c'était une loco à vapeur qui lâchait sa fumée sur les wagons et sur les visages quand on regardait par la fenêtre, puis aussi parce qu'ils embarquaient à la Gare d'Orléans – gare d'Orsay, si merveilleuse, si belle et si lumineuse nous disait-elle.
Par contre le changement de train à Limoges était moins apprécié ; elle reconnaît toutefois que la gare de Limoges est un chef d’œuvre architectural, mais elle devait quitter son grand train Paris-Toulouse à regret pour un tortillard départemental ordinaire qui desservait la petite gare de Salon-la-Tour.
Trois heures d'attente dans cette grande gare, capitale du Limousin, était un enfer pour une gamine de 5 ans. Alors que faire pour occuper son temps ?
Facile nous répond-elle : il y avait un cheminot – elle a su plus tard qu'on l'appelait « lampiste » – qui installait toutes ses lanternes autour d'un énorme pilier, prêtes à être allumées. Dans un premier temps elle faisait le tour pour admirer les différentes couleurs de vitres, les cuivres étincelants et la finesse de la décoration pour certaines. Après que l'employé les ait allumées une à une, elle les admirait à nouveau car la flamme ravivait les couleurs.
Mais le jeu ne s'arrêtait pas là ! Dès que le personnage tournait les talons elle s'empressait d'éteindre une à une les lanternes ; ce qui provoquait, on s'en doute la colère du préposé à son retour. Il paraît qu'il vociférait à tout-va en injuriant un hypothétique garnement car il était loin d'imaginer que c'était une petite fille qui le tourmentait.
Deux années de suite le jeu en valait la chandelle, si je puis dire.
La troisième année fut autre car le père de ma tante avait compris le jeu, lui qui connaissait bien son espiègle de fille. Ni fessée, ni gifles mais des remontrances qui pesaient lourd à l'époque.
Plus tard, les trois heures d'attente étaient vite avalées par la lecture d'un « illustré » nommé les « Pieds Nickelés » Tiens donc !!!...
Avant dans les bourgs
juillet 2013
Parce que c'était comme ça…avant.
Allons bon ! Voilà encore un billet empreint de nostalgie, un billet rétro, ringard, "has been".
Non, non, seulement un témoignage face à quelques réflexions lancées à la va-vite sur certaines de mes expos : "c'est trop chargé".
A l'origine de ce billet ; une réflexion récente devant un des superbes réseaux exposé à Orléans. j'étais en train de dire à nos amis qu'on n'avait rien à reprocher à ce dernier sauf, peut-être, le manque de vie avec une carence de personnages. C'est alors qu'un autre visiteur intervient, gentiment, en nous disant : "c'était comme ça, avant, dans les villages, il n'y avait pas grand monde".
Nous n'avons pas rétorqué ; le bruit de la foule ne permettant pas le dialogue.
Mon village adoptif sarthois (Paris étant mon village natal) comptait dans les années 50/60 à peu près le même nombre d'habitants que maintenant c'est à dire sept ou huit cents.
Les automobiles y étaient peu nombreuses, j'en veux pour preuve : mes copains et moi-même jouions au "Jokari" sur l'unique place du village, celle de l'église, imaginez maintenant ! Par contre tout le monde circulait à pieds :
- on ne déposait pas les enfants devant l'école en voiture, donc les trottoirs étaient très animés
- le matin les 2 boulangeries, les 2 boucheries, les 4 alimentations ne désemplissaient pas puisque la grande distribution n'existait pas
- le soir à 18 heures sonnantes les deux fermes du bourg ouvraient leurs portes pour vendre le lait, la crème, le beurre et le fromage blanc dans les faisselles. L'une était dans le haut du bourg et l'autre dans le bas ; il y avait ainsi un chassé-croisé où la communication, la vraie, la directe, était de mise. Quand on faisait la queue avec notre pot au lait on avait le temps de prendre des nouvelles de l'un ou de l'autre, et tout le monde en profitait.
- quelquefois, en semaine, le "tambour" délégué par la commune, s'arrêtait tous les 100 mètres pour lancer son "avisse à la population" et les habitants sortaient pour écouter les dernières nouvelles de la municipalité (coupure d'électricité programmée par EDF, passage des pompiers pour les calendriers, changement d'horaire pour le ramassage des poubelles etc.)
- le dimanche, et chaque dimanche, il y avait la messe où les enfants du catéchisme faisaient pointer leur carte auprès de monsieur le curé
- certains dimanches, il y avait les baptêmes où la tradition voulait que les parrain et marraine lancent à la volée dragées et pièces de monnaie. Nous, gamins étions prêts à nous jeter dessus alors que tout était à même le bitume, imaginez maintenant !
- faut-il vous parler des courses cyclistes où les trottoirs étaient pleins de supporters
- faut-il vous parler des mariages où le plus souvent une grande partie de la population était invitée à assister à la messe
- faut-il vous parler des enterrements où toute la population se faisait un devoir d'accompagner un des leurs dans sa dernière demeure
- faut-il vous parler des longs voyages en train pour regagner la capitale, debout dans le couloir, tant il y avait foule sur le quai de la gare.
Voilà donc pourquoi sur nos réseaux des années 50/60 les rues sont pleines de badauds et que les quais de gares affichent complet.
A mon avis, tenir compte de tout ceci fait partie de la déco époque 3 (1945 à 1970 dans le jargon du modélisme ferroviaire).
Ces réseaux, comme le mien, ne sont pas chargés, ils sont vivants, tout simplement !
Elle est plus âgée que moi
juin 2013
J'en rêvais depuis longtemps : une bonne trentaine d'années, précisément, quand nous avons fait ressurgir le petit train avec Papa. Il avait pris pour habitude de collecter et d'archiver toute sorte de documentation concernant le train miniature. La boutique du RMA était un lieu que nous fréquentions assez souvent dans les années 50. Il y avait aussi le «Salon de l'enfance», les Grands Magasins, sans oublier les petites boutiques parisiennes, nombreuses à l'époque, qui distillaient copieusement conseils et prospectus. Tous ces papiers, classés et répertoriés par marques, que je ne consultais jamais, tellement il y en avait, étaient rangés dans des cartons. Trop c'est trop dit-on. Et puis, quand on est gamin, à quoi bon s'arrêter devant du matériel qu'on ne possèdera peut-être jamais ! Les catalogues de Noël suffisaient amplement pour faire notre choix.
C'est donc adulte que je compris la valeur de ces documents. Ça m'a permis de redécouvrir toute la gamme SMCF, le matériel VB, wagons et locos, le matériel TAB, JEP, HORNBY et bien d'autres qui, par contre, m'étaient moins familiers. La sympathique publicité ANTAL me subjugua au premier coup d'œil, au point de désirer cette loco «3 rails» comme les miennes, métal comme les miennes, avec un nom «Pacific» qui me plaisait bien*.
Internet et e-bay n'existant pas encore en 1980, les brocantes n'étant pas très répandues à cette époque et les petites boutiques n'ayant plus en rayon depuis fort longtemps ce modèle de loco, je m'étais fait une raison : ce vieux modèle est inaccessible. J'en avais fait mon deuil.
Depuis 3 ou 4 ans je l'ai vue réapparaître sur e-bay et chez certains revendeurs.
L'espoir renaît.
Philopuces, un collectionneur déjà cité sur mon site pour sa passion contagieuse me contacte pour une loco BASCOU, successeur de ANTAL. Celle-ci, fort belle j'en conviens, est en 2 rails. Mais il lui reste une ANTAL en 3 rails d'origine.
Elle date de 1949, ce n'est pas le tout premier modèle mais par contre elle gagne en finesse et en fiabilité. Je fais le grand pas après avoir concerté Eliane, mon épouse. L'occasion est trop belle et ne se reproduira peut-être pas tout de suite.
La voici donc dans ma collection depuis quelques jours.
Samedi et dimanche nous participions au salon de la maquette d'Argentan, sous-préfecture de l'Orne. Une fois le réseau installé, je dépose délicatement ma machine sur les rails et, après une très brève hésitation, la voilà qui démarre en douceur, activant ses bielles qui apparemment ont échappé aux rhumatismes dus à leur grand âge. J'ai appris depuis, que ce modèle en courant continu avait tendance à chauffer, plus qu'en alternatif. C'est vrai, je l'ai constaté – il me reste à la ménager. D'un autre côté, à cette époque, on ne mettait pas de bandage sur les roues motrices ; la PACIFIC 231 (c'est son nom) tire de ce fait moins de wagons – elle aura donc un régime de faveur en faisant une apparition de temps à autres. Je préserverai ainsi ses artères, son cœur et son squelette.
A la maison elle repose précieusement dans sa boîte d'origine en attendant la prochaine expo. Elle est prête à montrer à ses jeunes consoeurs** de quel bois elle se chauffe (charbon en l'occurrence !).
* Antal dans la période après-guerre mise sur la petitesse du HO par rapport au gros «Zéro» (photo de gauche)
** la petite BB 9001 de marque VB – et la grande CC 7107 de marque TAB sont de 1955
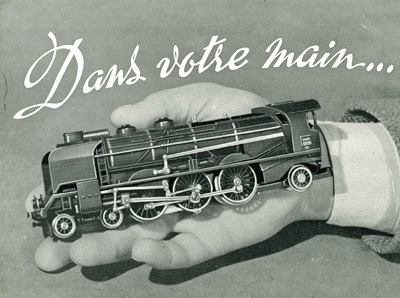
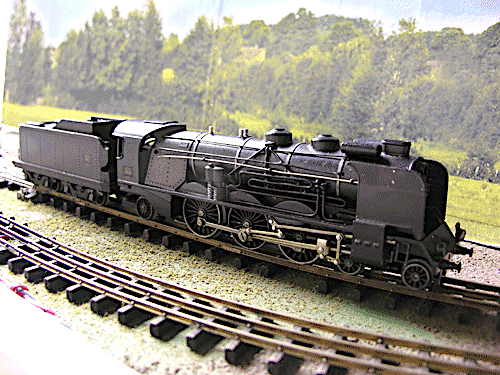
Hors sujet
Premier "coup de gueule" de l'année (juin 2013) n'ayant aucun rapport avec le "ferroviaire" !
Depuis les dernières présidentielles, pour échapper à la campagne électorale, nous avons changé de longueur d'ondes, autrement dit de radio. Afin de ne pas être englués dans la publicité abusive sur certaines stations, nous écoutions depuis de longues, longues années, France Inter en écoutant Gérard Sire, Lucien Jeunesse, Pierre Desproges et Jean-Pierre Chabrol. Mais France-Inter comme bien d'autres postes nous rebattent les oreilles de leurs infos noires, négatives et sans espoir. Nous l'avons donc abandonnée au profit de France-Musique qui distille non seulement du classique mais également du Jazz et de la chanson française digne de ce nom. Les quelques spots d'informations sont digestes et peu nombreux ; les commentateurs ne sont pas aux pièces, la programmation est sereine, l'écoute est agréable.
En décembre dernier, le 20 très exactement, France-Musique nous annonce dès le matin : "nous ne sommes pas en mesure de vous proposer nos programmes habituels suite à une grève d'une partie du personnel en solidarité avec les techniciens de France-Inter ayant pour cause une délocalisation dont un poste à Guéret".
A Guéret, vous avez bien lu ! Comme nous, nous l'avons entendu : à Guéret !
On ose envoyer un technicien chez les pestiférés de la Creuse ! Diantre ! Fouchtra !
Alors voilà : coup de gueule !
Quel manque de tact, quelle indélicatesse, quel manque d'élégance. Le parisianisme dans toute sa splendeur ! L'humiliation directe et incisive dans toute sa grandeur.
Dany Boon a réussi dans son exploit à faire reconnaître le Nord et ses ch'tis ; n'y-a-t-il pas un Dany Boon en Limousin ?
Finalement cette question se pose pour toutes nos provinces. Et je me demande vraiment pourquoi nos routes et autoroutes sont encombrées de franciliens tous les week-ends, pour venir chercher chez nous, oxygène, verdure, calme et authenticité. Peut-être que les racines (pas si lointaines) de nos chers parisiens* sont en "région" ! On devrait remettre en service les octrois, non pas pour rentrer dans Paris mais pour éviter qu'ils en sortent !
Pas étonnant, face à cette attitude, que nous ayons des difficultés à trouver des jeunes médecins, des dentistes et bien d'autres spécialistes, pour venir s'installer dans nos villages, dans nos petites villes de campagne.
Nous, on regarde passer les TGV, les voitures sur les autoroutes et les avions dans leurs trainées blanches : au milieu, rien – nous, qui attendons qu'on veuille bien nous lancer des cacahuètes !
C'est vrai, je suis fâché !!! et pourtant j'ai laissé du temps s'écouler mais il fallait que je vous en fasse part. Quelques jours plus tard le mouvement de grève était répété mais le message avait changé ; un élu creusois avait peut-être rué dans les brancards (Dame, dans les rues de Guéret y a p't'être encore des ch'vaux !)
*Papa est né à Paris, je suis né à Paris et y ai vécu une trentaine d'années ; maintenant j'habite un bourg de 300 habitants, j'ai la télé, l'eau chaude et internet !
Trinville, Trinville, pays tranquille
juillet 2013
Un de mes voisins, le plus sympa du quartier, vit seul depuis longtemps. Ancien parisien, il a retrouvé le plaisir de vivre dans notre campagne et particulièrement dans son jardin ; jardin potager et jardin d'agrément. Afin de briser sa solitude il ne quitte pas son "transistor" qu'il déplace au gré de ses tâches botaniques et quand il est plongé dans ses rangs de haricots on l'entend rire ou commenter les réflexions des "Grosses Têtes" de RTL.
Philippe Bouvard et toute son équipe s'invitent tous les jours dans son jardin. Nous nous sommes habitués à ses rires et on pense tout bas : "tiens, on a dû en louper une bonne". Mais il n'est pas égoïste car à chaque fois que son jardin produit à outrance il nous en fait profiter : salades, courgettes, haricots, le tout agrémenté d'une sélection de bonnes blagues !
C'est ainsi qu'un jour il me dit : "Philippe, j'en ai une bonne à te raconter sur le p'tit train".
Je lui rétorque qu'une fois n'est pas coutume car il est vrai qu'on entend beaucoup plus souvent des histoires sur les belges, les blondes et les politiques.
Alors voilà (je vous la livre toute crue, dans le jargon de la bande à Bouvard)
Un gamin joue au train, sur le tapis du salon. La mère surveille son rejeton en buvant son thé.
Un tour de circuit, puis deux et le train s'arrête en gare. Le gamin annonce à voix haute façon chef de gare : Tarascon, Tarascon, deux minutes d'arrêt, Tarascon, pays de cons. Sa mère horrifiée sursaute et lui lance : Pierre-Henri quel est donc ce langage ! mesurez vos paroles mon ami.
Un tour de circuit, puis deux et le train s'arrête de nouveau en gare. Le gamin annonce à voix haute : Montélimar, Montélimar, deux minutes d'arrêt, Montélimar, pays de connards. Sa mère se lève et bondit tout en lui montrant du doigt le grand escalier : "Jeune homme, en voilà assez, montez dans votre chambre et vous ne redescendrez que dans deux heures"
- "bien mère, oui mère" et le gamin s'exécute.
Deux heures plus tard il redescend.
Madame feuillette un magazine.
Le train repart pour deux tours de circuit avant de s'immobiliser en gare et Pierre-Henri annonce, très calme et très sûr de lui : Annemasse, Annemasse, deux heures de retard, à cause d'une connasse …
Allez, souriez, c’était ça la bande à Bouvard !
Sommes-nous devenus si bêtes ?
juillet 2013
Ça ne vous aura pas échappé ; quand on achète quoi que ce soit, le fabricant, via la notice d'emploi, nous prend vraiment pour des imbéciles. On nous rappelle gentiment (protection juridique oblige) que notre aspirateur ne doit pas absorber des cendres chaudes surtout rouges, qu'il ne faut pas mettre à sécher nos animaux de compagnie dans le four à micro-ondes ou encore que notre sèche-cheveux ne doit pas être plongé dans la baignoire (quoique Claude François pour changer une ampoule…). Il en va de même pour toutes les mentions obligatoires qu'un imprimeur, ou qu'un publicitaire, doit inscrire sur les emballages.
Voilà donc pourquoi cette semaine je vous détaille une boîte d'origine SMCF (Super Modèles de Chemin de Fer) des années 50. Vous aurez beau la tourner dans tous les sens, il n'y est marqué que l'essentiel. Sur un des plus petits côtés le "marchand" a noté le nom de l'article, le reste étant imprimé d'origine : la marque, l'échelle, construction métal et plastique "CHOC" incassable, reproduction exacte.
Ne cherchez pas la mention si incongrue : photo non contractuelle.
A l'époque quand on achetait un wagon (une voiture) dans cette boîte on ne s'attendait pas, en l'ouvrant, à trouver la loco, la voiture postale, la voiture restaurant, le fourgon de queue et le paysage de montagnes par-dessus le marché !!!
On n'était pas bête : même nous, enfants, quand on déballait nos cadeaux au pied du sapin, on savait.
Maintenant, avec cette mention qui protège tout le monde en amont, quand on achète un siège de plage, il ne faut pas s'attendre, en déballant notre carton, à y trouver les cocotiers qui vont avec et …la superbe blonde en bikini qui vous invite à vous y asseoir !
Quand on achète une automobile je n'ai pas remarqué si le concessionnaire nous précisait qu'il fallait le permis de conduire.
Et quand on achète une loco ? est-ce que le vendeur s'inquiète de savoir si on aime jouer au petit train ?!!!?

Créez votre propre site internet avec Webador